Vincennes attendra près de quatre ans pour voir un roi passer de nouveau son seuil. Et quel roi ! Henri IV devant qui les troupes fanatisées de la Ligue ont fini par fondre comme beurre au soleil. L’état du château le désole. Il aimerait bien le reconstruire ou même seulement le réparer. Malheureusement il n’a pas d’argent. La France qu’il faut guérir et les femmes – mais il n’a jamais fait de doute pour personne que la France ne soit femme – lui coûtent cher. La seule qui lui apportera une fortune, sa seconde femme Marie de Médicis, la grosse banquière, finira par le faire assassiner pour avoir la paix. Ou tout du moins sa paix à elle.
C’est pourtant elle qui reprend le projet de reconstruction et, le 17 août 1610, le jeune Louis XIII, encore en grand deuil – le coup de couteau de Ravaillac date de trois mois – pose la première pierre de ce qui sera le Pavillon du Roi. Nom parfaitement justifié : Louis XIII y passera une grande partie de sa jeunesse. Lui et surtout Richelieu reprennent l’idée de Louis XI. Le donjon avait vu passer quelques prisonniers de qualité mais le règne du grand cardinal inaugure la période des captifs de grande classe.
D’abord, le prince Henri II de Condé, père de la fameuse duchesse de Longueville qui, d’ailleurs, verra le jour à Vincennes, sa mère ayant obtenu permission d’accompagner son père. Ensuite, les Vendôme, Alexandre et César, bâtards d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrées, le maréchal d’Ornano qui y meurt ainsi qu’Alexandre de Vendôme dans des conditions qui laissent flotter une senteur de poison. Le maréchal de Puylaurens qui a le même sort. On parle, même, mais à mots couverts, de certain cachot qui vaudrait « son pesant d’arsenic ».
Plus grands encore sont les prisonniers issus de la Fronde : le fameux duc de Beaufort, le roi des Halles, fils de César de Vendôme, qui s’évade, après trois ans de captivité, à l’aide d’une échelle de corde cachée dans un énorme pâté. Puis de nouveau des Condé : le plus grand d’abord, le fameux vainqueur de Rocroi, son frère Conti et son beau-frère Longueville. Et pour finir, en 1652, le trublion majeur de la Fronde, le fameux cardinal de Retz.
Revenu au pouvoir, Mazarin songe que Vincennes pourrait lui rendre de grands services, ne fût-ce que pour y abriter ses trésors mais sachant qu’il ne peut s’annexer un domaine royal pour lui tout seul. Il achève le Pavillon du Roi, fait élever celui de la Reine – le tout par Le Vau – et projette un parc magnifique avec jeux d’eaux et cascades qui rejoindraient la Seine. La mort ne lui laisse pas le temps de réaliser ce grandiose projet. Et c’est à Vincennes qu’il meurt, le 8 février 1651, au rez-de-chaussée du Pavillon du Roi (aujourd’hui Archives des armées, le Pavillon de la Reine enfermant celles de la Marine). On sait que Louis XIV préfère Saint-Germain et surtout Versailles qu’il a déjà en tête. Il trouvera tout de même le donjon assez bon pour recevoir le surintendant Fouquet arrêté après sa trop somptueuse fête de Vaux et qui va y attendre son procès en compagnie de son gardien particulier, d’Artagnan, capitaine-lieutenant des mousquetaires.
C’en est fini des pompes royales à Vincennes. Un temps résidence de souverains étrangers de passage, il restera prison puis accueillera toutes sortes d’avatars : fabrique de porcelaine, école de cadets. Parmi les prisonniers de marque : Diderot, Mirabeau, tout plein de sa passion pour Sophie de Monnier, le fameux Latude, recordman du monde de l’évasion qui s’en va, un jour, par la porte.
La Révolution transforme le château en poudrière et enferme au Pavillon du Roi les filles de joie. Mais l’heure du drame approche. Celui dont Talleyrand, qui n’en est pas tout à fait innocent, dira : « C’est plus qu’un crime, c’est une faute. »
Au soir du 20 mars 1804, vers cinq heures et demie, une voiture fermée enveloppée d’un escadron de cavalerie pénètre dans la cour du château. Elle renferme un jeune homme de trente-deux ans. C’est encore un Condé. C’est même le dernier.
Louis-Antoine-Henri de Bourbon-Condé, duc d’Enghien, a été enlevé cinq jours plus tôt, au mépris de tout droit et au prix d’une violation de frontière, à Ettenheim, petite ville de la Forêt-Noire où il menait une vie paisible en apparence auprès de celle qu’il aimait et dont on disait qu’il avait fait son épouse morganatique en dépit de l’opposition du vieux Condé. Charlotte de Rohan, nièce du célèbre cardinal de Rohan, héros de l’affaire du Collier2, donne asile au jeune couple. L’enlèvement, dirigé par le général Hulin, a été ordonné par Bonaparte qui voit, dans le prince, le centre actif de toute l’agitation royaliste.
Quand il pénètre à Vincennes, Enghien ignore qu’il va mourir. Comment l’imaginerait-il ? Prisonnier politique, soit ! mais de là à imaginer qu’on va, quelques heures plus tard, sans même l’ombre d’un jugement, le fusiller dans un fossé boueux et l’y enterrer séance tenante, il y a un monde. C’est pourtant ce qui se produit. Réveillé à minuit dans le Pavillon du Roi où il a été installé, le prince, après un semblant d’interrogatoire, est conduit dans les fossés de Vincennes et passé par les armes. Il est alors deux heures trente. Le corps sera enterré sur place. Bonaparte n’a même pas accordé à sa victime l’audience qu’elle réclamait.
Quatre ans plus tard, en 1808, Napoléon, Dieu sait pourquoi, fera raser les tours de Vincennes à la hauteur de la cour, n’épargnant que le donjon et la tour du Village. Peut-être était-il gêné par cet antique symbole de la puissance royale ou par un souvenir plus récent ? Il faudra attendre 1816 pour que le corps du jeune duc d’Enghien soit tiré de son fossé et enterré dans la Sainte-Chapelle sous le mausolée de Bosio où il se trouve toujours. Mais, entre-temps, Vincennes a vécu une belle page de gloire.
En 1814, le gouverneur, c’est le général Daumesnil qui a perdu une jambe à Wagram. L’Empire s’écroule mais Vincennes, qui renferme encore une grande quantité de poudre, d’armes et de munitions, n’a pas cessé de se défendre avec acharnement. Et tandis que Marmont capitule à Belleville, Daumesnil réussit à faire rentrer encore d’autres armes.
Désespérant d’en venir à bout, les Alliés lui envoient un ambassadeur pour le prier de rendre sa forteresse.
« Je vous rendrai Vincennes quand les Autrichiens me rendront ma jambe ! » déclare Daumesnil, et comme l’autre insiste, menaçant de bombarder le château, il ricane : « Je ferai tout sauter avec vous et si je vous rencontre en l’air, je ne réponds point de vous égratigner. »
Il faudra l’abdication de l’Empereur pour convaincre l’héroïque mutilé des droits que Louis XVIII a désormais sur le château. Pour le punir de sa résistance, on lui offre un exil à peine déguisé à Condé. Mais Louis-Philippe, devenu roi, rappellera Daumesnil et c’est à Vincennes que finalement il mourra du choléra.
Horaires d’ouverture
Du 2 mai au 31 août 10 h-18 h Du 1er septembre au 30 avril 10 h-17 h
Fermé le 1er janvier, le 1er mai, les 1er et 11 novembre et le 25 décembre.
http://www.chateau-vincennes.fr/
1- Voir Château-Gaillard.
2- Voir Saverne.
Vizille
Marie Vignon, duchesse
Une belle femme qui a les qualités d’un honnête homme est ce qu’il y a au monde d’un commerce plus délicieux.
Elles sont légion, en France, les anciennes forteresses remises au goût du jour pour le caprice d’une jolie femme. Vizille ne fait pas exception. Quand, en 1600, François de Bonne, seigneur de Lesdiguières et lieutenant général des armées du roi Henri IV pour le Dauphiné, le Piémont et la Savoie, entreprend la reconstruction du vieux château, mal retapé par les troupes catholiques en 1562 pour y tenir garnison, c’est dans l’unique intention de plaire à la dame de ses pensées et de ses « joyeux esbatements », Marie Vignon, une jolie marchande de soieries grenobloise dont Lesdiguières est fou depuis dix ans déjà. Il faut bien avouer qu’il y a de quoi.
La première rencontre a eu lieu le 16 décembre 1590.
Ce jour-là, Lesdiguières entre dans Grenoble à la tête des troupes protestantes dont il est le chef au nom du roi Henri IV qui, à cette époque, n’est pas tout à fait roi car il ne lui est pas encore apparu que Paris valait bien une messe.
Donc, Lesdiguières entre. Sur son passage, la foule se presse, clame son enthousiasme. Au premier rang, une adorable créature blonde, ronde et rose crie plus fort que tout le monde. Bien mieux, elle écarte ses voisins, s’avance au risque de se faire fouler aux pieds par le cheval et tend à Lesdiguières une petite branche de gui, ce qui oblige le héros à la regarder : « Dieu quel morceau ! » écrit René Fonvieille, biographe du couple. Et en vérité on ne saurait mieux dire. Lesdiguières est ébloui et quand il se penche pour embrasser la jolie créature, il y met tout son cœur. On se reverra ! Et bientôt même : quelques jours plus tard la dame à la branche de gui tombe dans les bras de Lesdiguières et n’en sortira plus avant que la mort ne les sépare, trente-deux ans plus tard.
Est-elle à ce point amoureuse la jolie Marie aux yeux vifs ? À première vue on a peine à le croire. Lesdiguières a déjà cinquante-sept ans mais, rompu depuis la prime jeunesse à la vie des camps – il a choisi l’armée parce qu’il lui était tout à fait impossible de reprendre la charge de son royal notaire de père – c’est un gaillard tout en muscles, sec comme un sarment avec une figure qui ne manque ni de noblesse ni d’une certaine beauté. Et si ses cheveux grisonnent, du moins sont-ils toujours tous présents à l’appel.
La liaison rapidement affichée cause un vrai scandale. Marie Vignon est mariée et elle a même trois filles en dépit de son jeune âge. Son époux, Ennemond Matel, le marchand de soieries de la rue Revenderie, n’est pas de ceux qui aiment à porter des cornes. Il bat sa femme comme plâtre chaque fois qu’il la voit rentrer au logis avec, aux yeux, certains cernes révélateurs. Quant à Lesdiguières, il est marié, lui aussi, depuis le 11 novembre 1566 où il a épousé Claudine de Bérenger. Mais il ne s’en soucie que par moments car on la dit fort malade, tandis que Marie, c’est la santé, la fraîcheur. Les pasteurs calvinistes du Graisivaudan peuvent crier au scandale, invoquer Sodome et Gomorrhe, ils ne peuvent rien contre une telle passion.

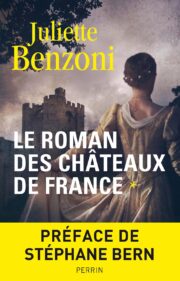
"Le roman des châteaux de France. Tome 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le roman des châteaux de France. Tome 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le roman des châteaux de France. Tome 1" друзьям в соцсетях.